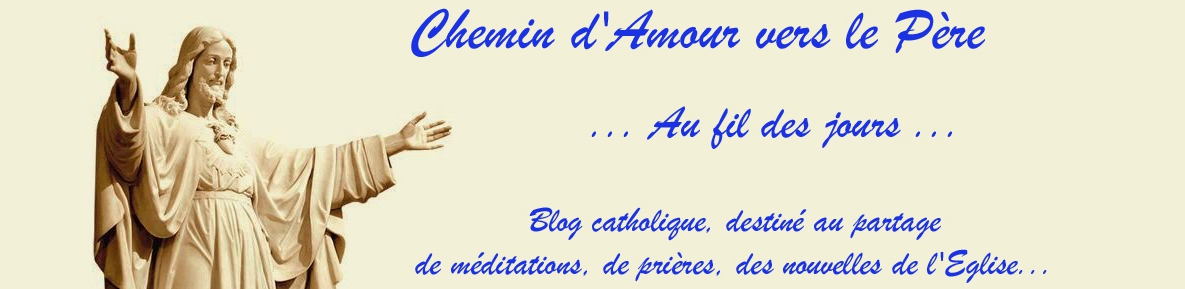chanoine
-
Vendredi 16 mai 2014
-
Lundi 21 avril 2014
Octave : Lundi de Pâques
(St Anselme, évêque, confesseur et docteur de l’Église)
Calendrier liturgique -
Mercredi 25 décembre 2013
Nativité de Notre Seigneur
Calendrier liturgique« La date historique de la nativité temporelle du Sauveur étant inconnue dans les premiers temps, une antique tradition, inaugurée peut-être au début du IIe siècle, célébrait les diverses théophanies du Christ dans sa nature mortelle, c’est-à-dire sa naissance, sa manifestation aux Mages et son baptême dans le Jourdain, peu après le solstice d’hiver, dans les dix premiers jours de janvier. Cette date conventionnelle avait déjà trouvé crédit dans toutes les Églises, quand, on ne sait comment, Rome dédoubla pour son compte la fête des Théophanies, anticipant au 25 décembre l’anniversaire de la naissance temporelle du Sauveur.
Quand et comment l’Église-mère arriva-t-elle à établir cette date ? Nous l’ignorons, puisque, sauf un texte très douteux du commentaire d’Hippolyte sur Daniel, le plus ancien document qui fixe Noël au 25 décembre est le calendrier philocalien de 336, qui porte cette indication : VIII Kal. ian. natus Christus in Betleem Iudee. Évidemment, le chronographe n’annonce rien de nouveau, mais il se fait l’écho de la tradition romaine antérieure, qui, dans le Liber Pontificalis prétend remonter jusqu’au pape Télesphore. Dans le discours fait à Saint-Pierre par le pape Libère donnant, le jour de Noël, le voile des vierges à Marcelline, sœur de saint Ambroise, on ne relève aucune allusion à la nouveauté de la fête, mais, au contraire, tout le contexte donne l’impression qu’il s’agit d’une solennité de vieille date, à laquelle le peuple a coutume d’accourir en foule, en vertu d’une ancienne habitude. La fête de Noël fut, au début, propre au siège apostolique. Saint Jean Chrysostome qui l’introduisit à Antioche vers 375, en appelle précisément à l’autorité de la capitale du monde latin, où, à son avis, seraient encore conservés les actes du recensement de Quirinus, avec la date précise de la naissance du Christ à Bethléem le 25 décembre. D’Antioche, la fête passa à Constantinople. Sous l’évêque Juvénal, entre 424 et 458, elle fut introduite à Jérusalem, puis, vers 430, fut admise à Alexandrie, et, de ces célèbres sièges patriarcaux, elle se répandit aussi peu à peu dans les diocèses qui en dépendaient. Actuellement, seuls les Arméniens monophysites célèbrent encore la naissance du Christ à sa date primitive, le 6 janvier.
Il ne faut pourtant pas négliger une coïncidence. Le calendrier civil du recueil philocalien note au 25 décembre le Natalis invicti, la naissance du soleil, et cette naissance coïncide justement avec le solstice d’hiver. A l’époque où, grâce aux mystères de Mithra, le culte de l’astre du jour avait pris un tel développement que, au dire de saint Léon, même les fidèles qui fréquentaient la basilique Vaticane, se permettaient d’y pratiquer le rite superstitieux de saluer d’abord, de l’atrium de l’Apôtre, le disque solaire, il n’est pas improbable que le siège apostolique, en anticipant au 25 décembre la naissance du Christ, ait voulu opposer au Sol invictus, Mithra, le vrai Soleil de justice, cherchant ainsi à détourner les fidèles du péril idolâtre des fêtes païennes. Dans une autre occasion, tout à fait semblable, c’est-à-dire pour la fête des Robigalia le 25 avril, Rome adopta une identique mesure de prudence, et, au cortège païen du pont Milvius, elle substitua la procession chrétienne qui parcourait le même trajet. »
Bx Cardinal Schuster (1880-1954), Liber Sacramentorum - Notes historiques et liturgiques sur le Missel Romain, Tome I, Vromant, Bruxelles, 1933.
-
Jeudi 12 décembre 2013
-
Le P. Maurice Garrigou (1766-1852) déclaré vénérable
Parmi les décrets de la Congrégation pour les causes des saints dont le Pape François a ordonné aujourd'hui la promulgation, et la reconnaissance des vertus héroïques de plusieurs serviteurs et servantes de Dieu (cf. ici la liste complète), se trouve un chanoine français, le P. Maurice Garrigou (1766-1852), fondateur de l'Institut Notre Dame de Compassion.
"Se voulant humble serviteur, ce prêtre marque la vie et le renouveau spirituels de l'Église de Toulouse par ses nombreuses fondations : la Congrégation de la Sainte-Épine, en 1804, pour développer chez les fidèles la dévotion à l'Ecce Homo, et l'affiliation à la Pieuse confrérie du Sacré-Cœur, symbole de l'immense amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ; la Congrégation des religieuses de Notre-Dame de la Compassion, en 1817, avec Mère Desclaux : « Jésus sera votre modèle, et l'Évangile votre règle », soutenue par les religieuses l'Œuvre des Plaies, association de dames vouées aux soins des malades."
(Extrait de sa biographie présentée dans la revue Esprit & Vie).
Fête du nouveau Vénérable : le 27 septembre.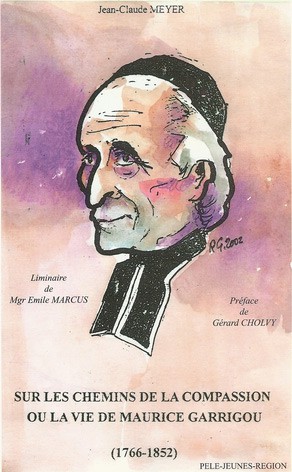
-
Lundi 9 décembre 2013
Calendrier liturgique
(La fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie est fêtée ce 9 décembre au nouveau calendrier) -
Mercredi 3 juillet 2013
-
Jeudi 16 mai 2013